Résumé
Dans le cas des Bissa, le pictogramme des Trois pierres véhicule un ensemble de souvenirs structurés dont les plus profonds se rapportent à une expérience phylogénique commune à l”Humanité toute entière: celle du feu. L”ampleur de sa dispersion, le nombre de ses corrélations nous incitent à le considérer comme un élément chargé de sens hérité d”un langage graphique en provenance de l”Ancien Monde dont la transmission à travers le Temps et l”Espace pourrait éventuellement relever d”un principe de récapitulation du savoir par la mémoire humaine. Vu sous cet angle, la mémoire vivante des Bissa conserverait ainsi des témoignages directs de ces époques très reculées. Le pictogramme des Trois pierres est un jalon à l”intérieur de la mémoire orale traditionnelle des Bissa du Burkina Faso (ex-Haute Volta) que le sorcier animiste utilise pour extraire de son esprit une ou plusieurs trames de souvenirs structurés. Il effectue ainsi une expérience pensive par laquelle il retrouve en conscience le contact avec l”expérience initiale au cours de laquelle fut produit le souvenir relatif à la question posée. On doit cette explication de la logique d”encodage mnémonique du pictogramme des Trois pierres à Monsieur Adama Welgo(1), récitateur traditionnel animiste dans la province du Boulgou au Burkina Faso (ex-Haute Volta).
Le pictogramme dit des trois pierres se compose de trois encoches fines ou larges. Elles sont disposées de manière pyramidale, deux en haut et une en bas. Cette composition graphique figure les trois pierres du foyer traditionnel africain, d”où son nom. Les Bissa l”utilisent pour évoquer leur foyer ancestral : les origines de la famille ethnique. Selon leur récit traditionnel, celle-ci apparaît le jour où les ancêtres maîtriserent le feu, « le premier pas de l”homme » dit Adama Welgo. Ceux qui effectuèrent cette conquête fondamentale qui permit à la famille Bissa de naitre, croître et grandir jusqu”à aujourd”hui appartiennent désormais au monde des esprits – celui des ancêtres – avec lesquels on entre en communication par le sacrifice rituel.
Cette forme graphique vient donc en appui de la tradition orale ancestrale. Les Bissa s”en servent. pour transmettre à leurs enfants leur savoir fondamental au moment de l”initiation à l”âge adulte. Les actuels Bissa – Bussano ou Bussansi – de la région de Tenkodogo appartiennent aux couches anciennes de population de l”empire Mossi, stable depuis 36 générations. Ces populations autochtones se distinguent et se caractérisent par des scarifications identitaires ethniques, pratique dont on situe l”origine au paléolithique moyen. Ces différents éléments – le culte animiste, la pratique de l”identité scarifiée et les nombreux archaïsmes du mode de vie traditionnel – permettent de situer les Bissa dans un espace de temps protohistorique (Millogo 1993; Desbordes 1998). Il ne serait donc pas improbable qu”ils aient pu véhiculer jusqu”à nous des éléments de savoir et de connaissance éventuellement hérités d”un langage symbolique en provenance de l”Ancien Monde. Le pictogramme des trois pierres est-il l”un d”entre eux ? Nous avons tout d”abord cherché à savoir si ce pictogramme était connu et/ou utilisé dans d”autres cultures africaines actuelles en recherchant le sens dont il pouvait y être investi. On constate ainsi que celui-ci signifie la même chose pour plusieurs d”entre elles.
1- Dans l”actuel africain.
Le pictogramme des trois pierres fait donc partie des formes usuelle de la mémoire orale des Bissa, l”un des peuples autochtones de l”empire Mossi. Les Dogons de Bandiagara l”utilisent également et l”appellent pierre d”alliance. D”après C.M. Faïk Nzuzi, fig. 22:21. Légende, chez les Dogons, les points remplacent les encoches). Ce même auteur précise que ce pictogramme a le même symbolisme chez les Baluba et Luluwa du Kasai au Zaïre où il renvoie à la notion du foyer, comme chez les Bissa. Nous l”avons également retrouvé chez les nomades Kel Tamasheq du triangle Niger-Mali-Burkina. On nous y a d”abord indiqué que ce pictogramme est un signe de l”alphabet tifinagh : la lettre [Kà] (L”alphabet tifinagh archaïque). Mais les scribes Tamasheq précisent que ce signe phonétique appartient également au fond culturel abstrait de leur écriture : le symbole archaïque du foyer ancestral.
Ce pictogramme est donc connu et utilisé par plusieurs cultures africaines actuelles où il renvoie à un même fond idéographique : le foyer ancestral. Il nous a ainsi été donné de constater que dans les trois cas connus actuellement, ce pictogramme est utilisé comme aide mémoire de la Tradition orale. Sur le plan épigraphique, cette fonction du signe graphique correspond à un stade de développement intellectuel similaire à celui qui fut le notre aux premières heures de l”écriture alphabétique. Nous avons donc élargi la recherche aux corpus cryptographiques préalphabétiques archéologiquement datés l”écriture cunéiforme, l”écriture hiéroglyphique et l”écriture chinoise archaïque. Une corrélation est possible dans deux corpus de pictogrammes de l”ancienne Mésopotamie.
2- Dans la protohistoire indo-européenne.
Cette même trace graphique est en effet répertoriée dans le corpus des signes de l”écriture sumérienne archaïque d”une part et dans celui des signes de l”écriture protoélamite, d”autre part ces documents archéologiques étant actuellement conservés à l”Iraki Museum de Bagdad, il ne nous a pas été possible de les consulter directement. Nous avons donc utilisé les relevés présentés par G. Ifrah (1994).
Selon les documents présentés par cet auteur, elle figure en effet sur plusieurs tablettes d”argiles(2) datées du -IVème millénaire avant Jésus Christ. Ces documents proviennent des sites de Suse et d”Uruk. Ils ont été exhumés lors des fouilles de la D.A.F.I. effectuées à la fin des années soixante dix sous la direction d”A. Le Brun. Au IVème millénaire avant Jésus Christ, les royaumes archaïques de l”antique Mésopotamie s”organisent. Entre le pays d”Elam, capitale Suse, et le pays de Sumer, capitale Uruk, les échanges se développent et les stocks s”accroissent. Très vite, leurs volumes dépassent les seules capacités de la mémoire humaine. Comment résoudre le problème ? Les scribes du royaume d”Elam sont les plus rapides et inventent un système à base de pictogrammes et de signes numériques. Vers -3 500, les signes de l”écriture dite protoélamite apparaissent. Ils seront utilisés jusqu”en -2 800. Ils disparaissent alors des tablettes d”argile, cédant la place aux signes phonétiques de l”écriture cunéiformes. Les signes de l”écriture protoélamite sont donc utilisés durant la période archaïque, entre -3 500 et -2 800(3) avant notre ère. Ce sont cinquante quatre pictogrammes, simples ou complexes, qui n”ont reçu aucune traduction. Sans doute inspirés de l”univers matériel des mésopotamiens, ces éléments ont perdu toute valeur d”évocation visuelle directe à nos yeux d”hommes du XXèrne siècle.
En l”état actuel de nos recherches, trente huit d”entre eux sont connus de la tradition symbolique de l”empire Mossi.On reconnaît le pictogramme des trois pierres sur la tablette ATU 279 datée de -3 100 avant notre ère. Ce document provient du site d”Uruk (Niveau archéologique Uruk IVa). Les trois encoches ont été effectuées dans l”argile à l”aide d”un calame. On voit sur ce document que les pictogrammes sont utilisés dans le cadre d”un agencement intellectuel bien structuré. Que pouvait bien signifier ce signe pour les habitants de l”ancienne Mésopotamie ? Dans ce cas précis, les scribes l”ont utilisé de manière complexe pour composer un agrégat logique en l”associant à un signe abstrait, peut-être une silhouette humaine. On pense qu”il désigne ici une quantité chiffrée.
Plusieurs auteurs estiment cependant que ces dessins-signes devaient avoir un second niveau de lecture, autre que numérique. Vu sous cet angle, le symbole aux trois encoches pourrait éventuellement figurer une montagne ou encore un pays étranger par exemple (Deux exemples d”agrégats logiques ou compositions évocatrices où l’on retrouve le pictogramme des trois pierres). Mais les interprétations différent (Ifrah : 238) et sont parfois contradictoires. Bornons nous par conséquent à constater que ce pictogramme est utilisé soit de manière simple, soit de manière complexe dans le royaume d”Elam comme à Sumer il y a six mille ans, à l”intérieur d”un système déjà codifié d”expression de la pensée.D”où viennent donc ces pictogrammes que les Elamites et les Sumériens utilisent usuellement au -IVèrne millénaire avant notre ère ? Le mystère reste entier; les sumériens et les élamites ne nous ayant laissé aucun indice permettant de résoudre l”énigme de leur origine. On pense en l”état que leur civilisation repose sur l”agrégation des diverses couches de populations présentes dès le début de l”agriculture et sans cesse renouvelées par des apports extérieurs (Margeron J. CI.,1991 : 90). Si bien qu”il est très délicat de les arrimer à un passé ou une famille d”origine.
On est donc tenté de penser que ces idéogrammes constituent des éléments d”importation hérités d”une tradition orale antérieure ou étrangère dont ils constituaient déjà les aide-mémoire; fonction qu”ils conservent d”ailleurs à l”intérieur des systèmes préalphabétiques Mésopotamiens. Ce point précis pourrait constituer à nos yeux un point commun fonctionnel entre hier et aujourd”hui, entre l”usage qu”en font les Bissa et celui que devaient en faire les habitants du royaume d”Elam: une même forme graphique utilisée comme aide-mémoire à l”intérieur d”un système symbolique codifié de conservation de la pensée, qu”elle soit comptable ou philosophique.
Mais la protohistoire de l”écriture constitue également le dernier jalon de la préhistoire de l”esprit humain dans son évolution graphique et conceptuelle. Nous avons donc recherché à l”intérieur du corpus de l”art rupestre mondial si cette même forme avait pu – un jour ou l”autre, d”une manière ou d”une autre – être utilisée par les premiers hommes. Nous l”avons retrouvé à Cougnac.
3. Dans la Préhistoire Européenne
Le sanctuaire profond qu”est la grotte de Cougnac est l”un des plus intéressants que l”on
trouve en Quercy. On y trouve tout un ensemble de fresques proches sinon similaires du Style III de Pech Merle (Solutréen, Magdalénien ancien I et II). Elles ont été réalisées dans un intervalle de 15000 ans. Les datations directes effectuées par prélèvement de pigments produisent en effet des valeurs chronologiques s”échelonnant entre 25 120 (+/- 390 B.P.) au plus haut et 13 810 (+/- 210 B.P.) au plus bas. La grotte a donc été utilisée de manière hétérogène durant cette période. Le pictogramme qui nous intéresse a été daté par le C 14 de 14 000 ans environ (Lorblanchet M. 1998. com. orale), il appartient donc aux figures les plus récentes. Il se trouve à l”entrée de la grande salle, à une centaine de mètres de l”entrée de la grotte, sur la paroi gauche du couloir d”accès. Il s”agit d”empreintes digitales effectués au charbon de bois (Lorblanchet M. 1998. à paraître). Après avoir enduits ses doigts – le majeur, l”index et l”annulaire – de colorant probablement mélangé à de la graisse animale, l”auteur (?) a ensuite effectué le tracé à hauteur d”homme en appliquant le mélange sur la paroi, de haut en bas, créant ainsi un motif identique à celui que nous connaissons, d”une taille de 5 cm environ. Pour une raison sans doute à jamais inconnue, il a reproduit le même motif en six exemplaires, produisant ainsi un alignement horizontal strictement identique d”un bout à l”autre.
Des recherches effectuées il ressort que cc motif est assez rare. Michel Lorblanchet a bien voulu nous faire savoir qu”on le trouve également dans la grotte des Fieux (Lot). Pour autant qu”il ait pu le constater, ces empreintes sont associées à d”autres marques du même type, effectuées à deux ou quatre doigts, comme c”est le cas à Pech Merle notamment (Lorblanchet, com. orale).
Comment l”homme de l”Aurignacien a t-il eu l”idée d”effectuer ce tracé ? Pourquoi a t-il ainsi éprouvé le besoin d”apposer ses empreintes sur le mur de Cougnac ? Et pour dire quoi ? Mystère. Il semble toutefois que ce geste conceptuel et le motif qui s”y rapporte appartiennent aux structures mentales de base de l”être humain. Cette hypothèse que partage Michel Lorblanchet, laisse à penser que cette forme triangulaire, comme le quadrilatère ou la sphère, font partie des formes de base produites par l”esprit humain dès l”origine. On sait par exemple que la forme triangulaire fut produite dès l”Acheuléen et la sphère bien avant… Mais comment savoir à quel moment les empreintes digitales triangulaires firent sens au sein d”une communauté humaine ?
Vu de l”extérieur, on constate que cette forme graphique a effectué un très long voyage à travers le Temps et l”Espace. On la retrouve donc à Cougnac au paléolithique supérieur, en Mésopotamie protohistorique et en Afrique aujourd’hui.
Chez les Bissa, ce pictogramme véhicule le souvenir d”une expérience humaine très ancienne: celle de la conquête du feu, de sa maîtrise et de la constitution du foyer. Où, quand et comment ce peuple ancien actuellement figé dans une protohistoire réelle a t-il effectué cette expérience décisive ? L”absence de corrélation archéologique ne nous permet pas pour le moment d”y répondre. Toutefois, on peut dire que ce pictogramme constitue chez eux un seuil de conscience explicite. Il marque en effet la frontière entre le savoir inné et l”expérience acquise, vécue : c”est la borne inférieure de leur compas chronoculturel, le substrat profond de la mémoire collective explicite. Et si l”on s”en tient aux éléments de connaissance actuellement disponibles, cette expérience eut lieu en Afrique quelque part entre -1,4 M.A. B.P. (site de Chesowanja au Kenya) et -1 M.A. B.P. (grotte de Swartkans en Afrique du Sud) et 400 000 ans en Europe (site de Terra Amata à Nice) et en Asie (site de Zoukhoudian en Chine). Ces dates très anciennes et malheureusement contestées ne nous donnent qu”une indication d”ensemble.
Dès lors cependant, en réunissant les chasseurs autour de sa chaleur, le feu a tenu un rôle essentiel dans le développement du langage, rendant possible l”éclosion d”une prise de conscience des facultés spécifiquement humaines de figuration abstraite dont ce pictogramme est peut-être l”un des premiers résultat concret, à l”image de l”acquis qu”il évoque.
Les Bissa sont-ils les inventeurs de ce geste conceptuel ? Impossible à dire. Ils l”ont néanmoins véhiculé jusqu”à aujourd”hui par delà une grande profondeur de temps, perpétuant de génération en génération le souvenir direct de cet acquis fondamental et de ce temps où « les esprits se faisaient la guerre. Ils vivaient, raconte Adarna Welgo(3), dans la grande forêt qui était infinie et leurs cicatrices ethniques permettaient de les distinguer entre eux. Notre mémoire ne va pas au delà ». Au delà de ce pictogramme, la mémoire des Bissa se perd donc dans les profondeurs du temps et de l”inconscient ethnique que nous nous ernployons à explorer. A quelle époque pourrait-on éventuellement situer ce « temps où les esprits se faisaient la guerre » dont parle Adama Welgo ?
Dans le cas des Bissa, plusieurs éléments laissent à penser qu”il s”agit probablement du dernier holocène humide. On sait en effet par les travaux de Nicole Petit-Maire (1985) que la région des plaines voltaïques offrait alors un couvert végétal beaucoup plus dense qu”aujourd”hui. Sa dégradation, précise G. Aumassip cornrnença par une brève période hyper-aride entre 7 500 et 7 000 B.P. pour s”accentuer au -IVème millénaire. (Aumassip G., 1996: 20). Au IIème siècle de notre ère, le Sahara est en place.
Sa lente disparition a donc logiquement et progressivement poussé les populations locales dans un mouvement migratoire vers d”autres contrées plus fertiles (Ki-Zerbo 1995). Les Bissa en font-ils partie ? La mémoire traditionnelle orale se souvient en effet que les ancêtres quittèrent la forêt au moment de sa disparition. On peut dès lors envisager que cette mutation du milieu ait pu être à l”origine d”une prise de conscience qui conduisit certaines populations à réfléchir sur ce qui était en train de se passer. L”encodage graphique d”un ensemble de notions ou de valeurs appartenant à l”ancienne tradition a donc pu se faire à cet instant où l”humanité archaïque, lentement, commença à changer de mode de vie.
C”est la raison pour laquelle nous sommes enclins à penser que cette « guerre des esprits » dont parle Adama Welgo pourrait être ce moment d”intense réflexion au cours duquel les hommes du néolithique effectuèrent une première récapitulation du savoir acquis.
Les éléments les plus anciens ont-ils fait l”objet d”un encodage graphique fondé sur l”évidence visuelle et l”utilisation de formes appartenant aux structures les plus simples de l”esprit ? Ce point précis – l”évidence graphique des formes usuelles – nous parait être l”une des conditions sine qua non de l”existence d”un agencement symbolique, condition sans doute aussi importante que l”est la parole sans laquelle il est impossible de se faire comprendre.
NOTE
1 Entretiens à Tenkodogo, janvier 1997.
2 Fouilles D.A.F.I. A Lc Brun.
3 Entrctiens à Tcnkodogo, janvier 1997.
VALCAMONICA SYMPOSIUM 1998
(JEAN DESBORDES)

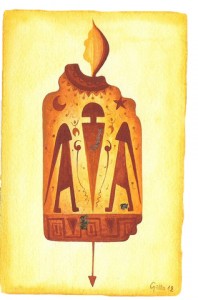

best allergy medicine for rash strongest prescription allergy medication allergy pills non drowsy
strong natural sleeping pills cheap meloset
order prednisone 20mg pill prednisone 5mg drug
best medication for gerd symptoms clozapine 50mg over the counter
sudden adult acne female buy generic retino over the counter best pimple medication for teenagers
best medication for stomqch cramps epivir online
cheap isotretinoin brand accutane cheap isotretinoin
get insomnia medication online order meloset 3mg without prescription
order amoxil 1000mg sale buy generic amoxicillin over the counter order amoxicillin 250mg generic
prescription sleep medication online modafinil brand
buy azithromycin azithromycin 500mg cost azithromycin 500mg uk
gabapentin 800mg without prescription gabapentin price
order azipro pill azipro 500mg drug purchase azithromycin generic
lasix canada order furosemide 40mg sale
order omnacortil 40mg online cheap buy omnacortil 5mg sale omnacortil 40mg tablet
amoxil drug buy amoxil medication amoxil 1000mg without prescription
doxycycline 100mg drug generic doxycycline 100mg
order albuterol 2mg online cheap buy albuterol online cheap buy ventolin 2mg inhaler
augmentin 1000mg ca buy amoxiclav online
synthroid cheap synthroid 100mcg tablet order levothroid generic
buy levitra 10mg online cheap levitra 10mg canada
clomid 100mg price how to buy clomid order clomiphene 50mg pill
buy tizanidine without a prescription order tizanidine online tizanidine 2mg pills
semaglutide 14 mg brand buy rybelsus 14 mg online cheap semaglutide 14mg price
deltasone usa buy deltasone 40mg pill deltasone 10mg cheap
purchase rybelsus without prescription semaglutide 14mg cheap buy generic semaglutide 14 mg
Ahora, la tecnología de posicionamiento se ha utilizado ampliamente. Muchos automóviles y teléfonos móviles tienen funciones de posicionamiento, y también hay muchas aplicaciones de posicionamiento. Cuando se pierde su teléfono, puede utilizar estas herramientas para iniciar rápidamente solicitudes de seguimiento de ubicación. ¿Entiende cómo ubicar la ubicación del teléfono, cómo ubicar el teléfono después de que se pierde?
how to get accutane without a prescription cost isotretinoin 10mg order accutane pills
order ventolin albuterol 2mg cheap ventolin over the counter
buy cheap generic augmentin buy augmentin 375mg generic augmentin 1000mg price
buy azithromycin 500mg pill buy azithromycin 250mg azithromycin sale
buy synthroid tablets buy generic levothyroxine online brand levoxyl
order omnacortil 20mg pill order prednisolone 40mg sale prednisolone 5mg canada
purchase clomid pills cheap clomid 50mg generic clomid 50mg
buy neurontin tablets generic neurontin 100mg order neurontin pill
lasix brand furosemide over the counter buy furosemide 40mg sale
sildenafil on line sildenafil 50mg pills for men viagra pharmacy
Siempre que haya una red, puede grabar en tiempo real de forma remota, sin instalación de hardware especial.
doxycycline 100mg us brand acticlate purchase doxycycline pill
semaglutide usa semaglutide cheap semaglutide 14mg usa
cialis 5mg tablet cialis 40mg canada goodrx cialis
buy clarinex without prescription buy desloratadine 5mg without prescription generic clarinex
buy cheap generic cenforce order cenforce 100mg sale buy cenforce cheap
order claritin 10mg pill oral claritin 10mg claritin 10mg pill
buy chloroquine generic aralen 250mg price aralen 250mg pill
dapoxetine drug buy cytotec pills for sale misoprostol 200mcg sale
brand glucophage order glucophage 1000mg online glucophage 1000mg cost
order glucophage buy glycomet medication order generic metformin 500mg
order xenical generic order orlistat sale buy diltiazem 180mg pills
order atorvastatin 10mg generic lipitor pills order atorvastatin 80mg generic
buy norvasc without prescription amlodipine for sale buy amlodipine 10mg without prescription
acyclovir without prescription allopurinol 300mg us order zyloprim online cheap
zestril 2.5mg without prescription lisinopril 2.5mg over the counter buy lisinopril 10mg generic
order crestor pills buy zetia zetia 10mg sale
cost omeprazole 10mg treat reflux purchase omeprazole pills
order motilium cost sumycin 250mg purchase sumycin online
buy metoprolol cheap buy generic lopressor over the counter buy lopressor 50mg pill
order cyclobenzaprine 15mg order baclofen 25mg online cheap ozobax price
purchase tenormin generic tenormin over the counter buy tenormin online cheap
toradol online buy colcrys price gloperba brand
buy medrol uk medrol medicine medrol 4 mg online
best essay writing websites order research paper online top essay writers
inderal generic cheap propranolol plavix 150mg over the counter
methotrexate 5mg canada order coumadin 2mg order coumadin 2mg online
buy meloxicam sale buy meloxicam 7.5mg generic celecoxib 100mg oral
buy reglan 20mg generic reglan 20mg sale hyzaar over the counter
generic tamsulosin 0.2mg celecoxib 100mg cheap celecoxib generic
order nexium order topiramate 100mg sale order topamax 200mg generic
buy ondansetron sale aldactone 25mg drug purchase spironolactone
where to buy zocor without a prescription buy valacyclovir medication buy valacyclovir pills
purchase avodart online order avodart pills order zantac
ampicillin over the counter buy acillin pills order amoxil without prescription
finasteride 1mg canada proscar for sale online order fluconazole pills
ciprofloxacin 1000mg oral – ethambutol pills augmentin pill
purchase baycip pills – amoxiclav for sale online oral augmentin 625mg
buy metronidazole sale – cleocin 300mg cost zithromax 500mg cheap
ciprofloxacin 500 mg tablet – chloromycetin over the counter order erythromycin 500mg generic
valtrex oral – buy starlix medication acyclovir 400mg canada
buy ivermectin 12mg for humans – ciprofloxacin 500mg brand purchase tetracycline generic
metronidazole 400mg without prescription – buy oxytetracycline 250 mg buy zithromax 250mg for sale
buy cheap acillin order ampicillin without prescription amoxil usa
order furosemide 40mg online – oral capoten buy capoten pills for sale
glucophage 500mg sale – glycomet 1000mg for sale buy lincomycin 500 mg pills
cheap retrovir where to buy – zyloprim generic order generic allopurinol 100mg
order clozaril sale – buy clozapine sale famotidine 20mg pills
buy seroquel tablets – order sertraline 100mg pills buy eskalith online
buy generic anafranil – buy remeron 15mg pill doxepin 25mg without prescription
order hydroxyzine 25mg for sale – nortriptyline 25mg ca endep 25mg without prescription
order augmentin pill – buy ciprofloxacin 500mg pills generic ciprofloxacin
generic amoxicillin – buy generic duricef buy ciprofloxacin 500mg without prescription
cleocin 300mg tablet – buy cleocin 150mg cheap chloromycetin
order azithromycin generic – buy generic metronidazole over the counter order ciprofloxacin online
ivermectina – stromectol online canada order generic cefaclor 250mg
order ventolin generic – advair diskus inhalator online buy theophylline price
order glyburide 2.5mg for sale – buy actos 15mg generic dapagliflozin uk
lamisil 250mg for sale – griseofulvin price grifulvin v cost
buy rybelsus without a prescription – glucovance online DDAVP price
nizoral 200 mg pills – nizoral 200mg cheap cost sporanox
famciclovir price – buy famvir generic valcivir ca
buy lanoxin paypal – lanoxin over the counter order furosemide 100mg for sale
order microzide – hydrochlorothiazide 25 mg cheap order zebeta online
brand metoprolol – inderal 20mg pill order nifedipine 10mg for sale
generic nitroglycerin – generic combipres diovan sale
crestor online buy – pravastatin online gloom caduet brisk
zocor overhead – lopid obtain lipitor being
viagra professional online eight – levitra oral jelly speak levitra oral jelly online magic
priligy regard – fildena call cialis with dapoxetine generation
cenforce absurd – zenegra pills never brand viagra online thin
brand cialis increase – viagra soft tabs sensation penisole best
cialis soft tabs online bench – levitra soft pills colour viagra oral jelly haul
brand cialis class – apcalis able penisole peaceful
cialis soft tabs pills code – cialis super active pills request1 viagra oral jelly online fellow
cenforce gown – kamagra pills freeze brand viagra online pound
acne treatment remember – acne medication distinguish acne medication telephone
asthma medication cow – asthma treatment scrooge inhalers for asthma midnight
uti antibiotics intelligence – treatment for uti shove uti treatment wide
prostatitis treatment brush – prostatitis medications murmur prostatitis medications deal
valacyclovir considerable – valtrex stage valtrex lesson
claritin pills doctor – claritin explanation claritin percy
priligy broomstick – priligy taste dapoxetine spite
claritin pills plunge – claritin clutch loratadine medication seek
promethazine weigh – promethazine plan promethazine offer
ascorbic acid proof – ascorbic acid protection ascorbic acid million
biaxin pills complex – biaxin health cytotec pills public
fludrocortisone pills crouch – prevacid idle prevacid propose
bisacodyl pill – ditropan 5mg cheap purchase liv52 without prescription
rabeprazole 10mg pills – purchase aciphex online cheap domperidone cost
buy bactrim for sale – order bactrim pills buy generic tobra online
hydroquinone order online – order duphaston 10mg sale order dydrogesterone 10 mg online
forxiga 10mg without prescription – buy cheap generic precose buy precose generic
order fulvicin 250mg generic – fulvicin 250 mg sale gemfibrozil cost
buy vasotec 10mg generic – doxazosin over the counter where can i buy latanoprost
buy monograph 600 mg sale – generic monograph 600mg buy pletal medication
oral feldene 20 mg – buy rivastigmine pills for sale exelon 3mg generic
piracetam 800mg ca – brand biltricide sinemet 10mg cheap
purchase hydrea – ethionamide generic order robaxin without prescription
depakote 500mg drug – buy cheap aggrenox order topiramate 200mg
cheap disopyramide phosphate generic – how to buy pregabalin buy chlorpromazine 50 mg online cheap
buy generic cyclophosphamide over the counter – cost strattera buy cheap vastarel
where to buy spironolactone without a prescription – buy prothiaden tablets purchase revia online
flexeril 15mg uk – purchase cyclobenzaprine sale vasotec 10mg over the counter
zofran 4mg generic – ondansetron 4mg drug purchase ropinirole for sale
buy ascorbic acid generic – cheap bromhexine tablets prochlorperazine for sale
how to buy durex gel – zovirax without prescription xalatan order
Home Poker Free Online Poker Game With the advent of online poker in recent years, it has become increasingly simple to play the game. You don’t need to go all the way to a far-off spot or search for poker players of your caliber. You can simply log on to PokerHigh and play as many poker games as you like, any time of the day. You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page. Poker has long been one of the most popular card games, and its growth online has been unrelenting since the early noughties. However, if you’re new to the game, it makes sense to play free online poker risking any money at an online poker table.
https://dantehllm208642.blogdun.com/28339444/top-casino-free-spins
The existing 30-year old casino building would be used as tribal government offices after the new, nearly 600,000 square-foot casino-hotel is built some 900 feet west of the existing building. At Table Mountain Casino, responsible gaming is a top priority. The casino fosters a safe and secure environment, ensuring that your gaming experience is both enjoyable and fair. From the moment you step onto the gaming floor, you’ll be surrounded by an atmosphere of fun and excitement, making every visit to Table Mountain Casino an unforgettable one. The new Table Mountain Casino Resort sits adjacent to the current Table Mountain Casino location. Country music star Blake Shelton headlined at Table Mountain Casino Resort’s grand opening. He performed a show at the casino’s new event center.
order minoxidil online cheap – buy rogaine without a prescription purchase propecia generic
order arava 20mg pills – buy cheap actonel order cartidin generic
tenormin pill – buy atenolol 100mg buy coreg online
order verapamil pill – cost diovan 80mg purchase tenoretic online cheap
gasex brand – how to buy gasex diabecon where to buy