Résumé – Dans cette dissertation est exposée une théorie hiérobotanique relative au « Papaver Somniferum » et les stèles anthropomorphes de la Daunia. Monuments considérés par convention comme funéraires, au contraire comportent des données précieuses sur un système hiérocratique organisé, comparable aux grands cultes helléniques. Les stèles sont répertoriées comme des documents essentiels pour les recherches sur l’antique représentation graphique des opiacés, parce qu’elles ont des symboles et des narrations propres à l’usage sacré de la plante psycoactive. Le texte suivant est présenté comme un abrégé des considérations passées et un essai introductif à de nouvelles théories sur lesquelles l’auteur travaille.
Extrat: Eleusis, Journal of Psychoactive Plants and Compounds, New Series, 2002-2003. 6/7 Pagg. 71-82
pdf in italiano estratto da Ipogei, quaderni dell’IISS “S. Staffa” di Trinitapoli, Dicembre 2007, n.1, pp. 83-92
[nggallery id=66]Une rare iconographie sacrée
L’opium était-il une religion pour les Dauni? (1) En partie oui. Du moins en ce qui concerne le culte de leurs statues, les stèles féminines. C’est ce qui ressort d’une étude que j’ai conduite il y a quelques années sur la symbolique et la sémantique de ces monuments, caractérisés par des incisions rédigées en un typique langage idéographique (LEONE 1990/1996b). En tant que civilisation prélettrée, celle de Dauni a simplement exprimé sa conceptualité avec des symboles et des scénettes, d’une façon extrêmement généreuse, en nous transmettant une documentation iconographique si corpulente qu’elle est uniquement comparée à celle du Valcamonica.(2) Par de rares occasions, les artistes de la Daunia faisaient des représentations sur les vases, en les décorant d’une graphique géométrique très originale et appréciée, mais ils destinèrent la narration à la sculpture sacerdotale. Et c’est grâce à ce chanceux rôle documentaire que les stèles constituent les rares livres de pierres sur lesquels on peut voir le monde Dauni.
Les récits gravés occupent chaque espace disponible entre les habits et les accessoires qui décorent ces monuments. Ils sont de genre varié et se réfèrent à des dizaines d’épisodes, certains desquels se répétant comme des schémas idéographiques de mythes ou événements décisifs pour la liturgie. Parmi les scènes, qui sont apparemment facile à lire, on reconnaît des individus qui chassent, pêchent, combattent, voyagent sur des barques, se peignent, discutent, suivent une procession, portent des offrandes, accomplissent des rituels magico-thérapeutiques et peut-être même des initiations. Certaines des ces illustrations ouvrent une nouvelle porte sur la psychopharmacologie méditerranéenne.
Sculptures sacerdotales d’une antique philosophie dualiste
Presque certainement, la signification du récit illustré va outre le lisible et se pousse dans les méandres d’un milieu religieux distinct, remontant à un temps lointain et possédant des connotations nettement ethniques. En considérant le contexte de découverte des objets et des illustrations, on a l’impression de faire face aux fragments d’un système hiérocratique stratifié et bien organisé dans lequel on identifie les rôles des personnages et la signification de leurs actions. L’ensemble apparaît comme un grand culte sacerdotal accompli par divers prélats et adeptes mais centré sur deux figures sacrées principales : une masculine et une féminine. Représentées sur deux stèles et sur une classe particulière de vases en céramique.
Les attributs qui permettent leur identification sont : le pavot pour celles féminines et l’armure pour celles masculines. Le rôle psycoactif du pavot définit la catégorie féminine, regroupant les monuments les plus nombreux (fig.1). La condition martiale et guerrière définit la catégorie des monuments moins nombreux, celle masculine (fig.2), c´est-à-dire celle du paredro (une figure virile dérivée des stèles anthropomorphes de l’age de Bronze). Dans la religion des statues stèles et des statues menhir anthropomorphes, de l’après néolithique, les rôles de l’homme et de la femme personnifiaient sexuellement l’univers dualistique de la philosophie religieuse primitive (LEONE 2000a). L’interprétation de la fonction sacerdotale des stèles a été avancée par l’identification du pivot “magique” dessiné sur les monuments (LEONE 1990, 1995). Comme pour chaque théorie innovatrice, celle-ci aussi a du mal à être acceptée. Dans le milieu académique, elle n’est pas contestée mais n’est également pas proposée avec celle qui circule désormais depuis trente ans, à partir du moment où les stèles furent étudiées par Silvio Ferri.
Malgré sa préparation classique, Ferri n’a jamais fait l’hypothèse que ces monuments soient deux entités sacrées. Il les considérait comme des sculptures tombales, effigies stéréotypées de guerriers et notaires, et il essayait d’expliquer la narration dans un sens funéraire en l’assujettissant toujours au statut de la mort du défunt. Les personnages représentés dans les scènes étaient les « acteurs » qui participaient aux rituels déroulés pendant l’office d’un mort (FERRI 1962/71). Mais sa théorie manque de soutien archéologique et sémiologique. Pour ce qui concerne la découverte, il faut considérer le fait qu’aucune stèle (sur environ 2000 objets retrouvés) n’a jamais été trouvée dans une position clairement funéraire. Tandis que pour la sémiotique, il faut dire que l’archéologie des images enquête dans la structure synthétique de la narration et explique les dessins en se basant sur leurs associations graphiques. Cette méthode a mis en évidence la signification sémantique de la symbolique botanique et a révélé les argumentations sur la thérapeutique, la mantique et l’initiation.
Une symbolique papavérine
Il faut imaginer qu’à l’origine les stèles étaient colorées, recouvertes de scènes, plantées dans la terre (ou plutôt dans le sable) et concentrées en deux ou trois sanctuaires de l’ancienne lagune entre Siponto et Salapia (la plaine située derrière le Golfe de Manfredonia), un des lieux les plus suggestif des Pouilles. Cette ancienne lagune fut le berceau de leur culte, localisé sur des îles entourées de dédales fluviaux parcourables. Les illustrations reflètent bien cet habitat bénit par les dieux.
Comme il a été mentionné, celles-ci forment un couple composé d’un homme, vêtu d’une précieuse armure ciselée complétée d’une épée à la ceinture, de bouclier sur l’épaule et de protège-coeur au centre de la poitrine ; et d’une femme couverte d’un habit somptueusement décoré par de très délicats dessins géométriques, parée de colliers, de grosses broches, de pendentifs, d’amulettes, de gants et de tatouages, et toujours identifiée par deux pendentifs “oscillum” circulaires (ses attributs de reconnaissance) qui accrochés au niveau de la taille semblent osciller. Ces objets sont le centre de l’interprétation botanique, ils se rapportent d’une façon peu claire à quelques fonctions symboliques du pavot à opium. Ils rappellent indirectement le végétale renversé et déterminent avec exactitude le rôle du personnage féminin représenté sur la pierre. Une sorte de ” Reine des pavots”. L’existence sémantique de cette belle fleur aux couleurs lilas et violette est passée inaperçue jusqu’à présent parce que sa forme est trop schématisée et aussi parce que la culture archéologique conventionnelle n’apprécie pas les interprétations qui traitent de religions fondées sur l’usage des drogues, trop lourdes à accepter. Par conséquent la donnée sémiologique est refusée ou mal interprétée.
Cependant, c’est un fil conducteur qui permet de reconnaître le pavot sur les décorations, sur les vases sphériques caractéristiques avec un bord en entonnoir typiquement Daunis (fig.3), sur les bâtons-sceptres utilisés par la personne médecin comme métaphores pharmacologiques, et sur les voyants cercles-attributs qui à l’origine étaient colorés de rouge et violet foncé. La donnée commune se trouve dans la fidèle représentation graphique de la capsule, et par chance bien lisible dans de nombreux cas : les feuilles le long de la tige, la capsule complète du disque stigmatique, le pédoncule auquel se greffent les pétales à la base de la sphère (fig.4).
Analysons plus en profondeur la question sphérique des “oscillum”. Pour Silvio Ferri, ils étaient des “oscillum apotropaici” : des cercles magiques de résonance ou des cymbales métalliques “kymbala”, ayant la fonction d’éloigner les mauvais esprits grâce à leur son sinistre. Il ne leur attribuait pas une grande importance, pas même les rares fois où il les confondait avec des grenades (FERRI, Stele Daunie V, 1965 : 148). Pour cette classe de monuments, la centralité symbolique des cercles oscillants est capitale. Il n’existe aucune stèle féminine qui n’ait un attribut de ce genre. Malgré que ceux-ci subirent des réductions de nombre et de dimension, ils ne disparurent jamais. En origine ces attributs étaient grands et détaillés, fournis de ces signes qui en ont permis la correcte identification botanique. Les même qui ont éclairci la fonction d’autres objets similaires et la signification de certaines scènes jusqu’à présent incomprises.
Scènes à fond sacerdotal
Nous pouvons comprendre combien les Dauni connaissaient les effets de l’opium grâce à certaines scènes d’intervention thérapeutiques dans lesquelles l’application du narcotique est suggérée par la présence de malades (ou disciples) qui reçoivent des soins de la part des officiants ou médecins armés de pavots soporifiques comme si ceux-ci étaient des instruments de pouvoir , d’où le “bâton scepter”.
Dans quelques scènes le malade, assis, est avili (fig.5A) ou est troublé (fig.5B). Il est aussi évident que la personne qui lui fait face essaye de l’aider en lui administrant une boisson. Dans une autre scène d’une simplicité et d’une netteté extraordinaire, un second curandero est en pleine intervention sur le gros orteil d’un malade anesthésié grâce au pavot qu’il serre dans sa main droite (fig.6). Au musée de Manfredonia, où les monuments sont exposés au public, la fiche explicative décrit le récit de cette façon : «Scène de combat ritue ». Dans le même genre, la scène de la fig.5A a été décrite ainsi : « …la femme au riche manteau… et dont la tresse se termine par un nœud rond [la capsule de notre pavot] … tend un casque au mort. » (FERRI 1962 :110).
Au lieu d’être seulement considérée comme un moyen de guérison physique, l’application «pharmaceutique » peut prendre un sens plus large : c´est-à-dire, un moyen de guérison métaphorique et magique pendant dans laquelle les prêtres thérapeutes, ou plus vraisemblablement, les prêtresses, vêtues et coiffées comme les stèles féminines, manipulent le végétal et sont déléguées au culte.
Une autre série de stèles, au contraire, fait penser aux rites initiatiques. Le disciple est placé tête en bas par deux thérapeutes qui le tiennent par les pieds. Le fait qu’un d’eux ait un pavot (fig.7A) ou que la tête du disciple soit enfouie sous terre (fig.7B)(3), ou encore qu’il soit soutenu par les pieds grâce à une figure hiératique assise sur un trône (fig.7C), rend plausible une interprétation chamane de l’acte rituel, comparable à « l’abandon du corps ». Il est reconnu que la position renversée, exprimée dans un contexte sacré ou quand elle est associée à une échelle, entre dans la symbolique chamanique du voyage extrasensoriel, de la montée ou de la descente entre le monde supérieur et inférieur. Même les pavots vacillants sont accrochés à l’envers sur la ceinture, peut-être pour symboliser les précieuses semailles papavérines dans le monde souterrain et donc ce monde sacré qui selon l’idéologie Daunis semble être le siège des révélations et le règne de la divination onirique, mais aussi la demeure des esprits savants qui peuvent enseigner.
Un individu en tête à tête avec un esprit est certainement celui gravé sur une stèle extrêmement intéressante (fig.8). Il est représenté pendant qu’il est en entretien avec un chien monstrueux, après avoir bu une potion « psychotrope » (la scène où lui est offerte cette boisson se trouve plus haut). Le lien idéologique entre le pavot soporifique et les Enfers est infranchissable et archétypique. Avec les scènes d’ordre magico-thérapeutique s’énumèrent également celles comportant des individus transportés dans des états de conscience fortement altérés (SMC). Une situation éclatante, en ce sens, est celle dans laquelle un homme est sous SMC et « voyage » suspendu et renversé pendant que deux esprits monstrueux le transportent (Ils sont en présence d’un tiers à l’apparence encore plus épouvantables.) (fig.9).
La présence d’un monstre et d’êtres fantastiques passionne énormément Ferri, qui voyait en eux la manifestation des Enfers aux défunts représentés sur les monuments. Il y aussi des figures hiérophantes qui semblent en transe ou qui ont une attitude « prophétique ». Elles sont sur un trône et parfois en présence d’un adepte au culte du pavot (reconnaissable grâce à sa singulière coiffure : un gros pavot tressé dans les longs cheveux.) ou d’un interlocuteur qui semble attendre une réponse (fig.10). D’autres figures paraissent possédées et jouent d’un instrument ressemblant à une harpe. Elles peuvent être entourées d’oiseaux et gratifiées par des adeptes qui défilant en procession, leur apportent des dons ou transportent des pots en forme de pavot. Ici aussi intervient une précise symbolique et instrumentation chamanique : l’harpe et les volatiles. La première qui ravit et transporte grâce au son, les seconds qui rappellent l’envol et la légèreté typique du psychonaute.
Les faits concentrés sur des besoins ésotériques, comme les états altérés de la conscience qui font voyager dans des rêves peuplés par monstres et ancêtres, se retrouvent dans des cultes à caractère mystérieux, oraculaire et initiatique. Il est impossible de les ignorer et de ne pas y trouver de parallèles. Parmi les grands cultes sacerdotaux connus et proche de la Daunia (dans le temps et l’espace), il y a ceux de Delphes et d’Eleusis. Pour tous les deux, on suspecte l’utilisation de psycoactifs, bien que finalisés à une « spécialisation » sacerdotale. L’oracle pour Delphes et les initiations pour Eleusis. Ces cultes, qui plus qui moins, étaient soumis à divers tabou. Mais pour le culte des stèles daunis, au contraire, il est prématuré d’en définir la spécialisation et j’estime même qu’il n’y en avait pas qu’une. On peut dire cependant, au moins selon la riche représentation figurative, que le culte n’était pas particulièrement crypté et caché comme ceux grecs. Et c’est justement grâce à cela que l’on reconnaît son primitivisme, son être indigène et hybride à la fois, préclassique et ancré à des restes d’une Méditerranée antique et matriarcale.
Conclusions
Aux lumières de la découverte hiérbotanique, les monuments montrent les « portraits » d’un couple idolâtré. On voit ce même couple sur certains fragments de vase. Les céramographies le présentaient toujours de la même façon, comme pour évoquer un pacte avec les origines, une hiérogamie des rôles (peut-être de matrice néolithique). L’un face à l’autre pendant qu’ils serrent symboliquement un mystérieux végétal (pas toujours identifiable) (fig.11). Elle est une déesse ou une figure sacrée qui semble donner la plante au guerrier, armé tantôt d’une épée tantôt d’une lance. Elle a toujours un long habit arrivant jusqu’aux pieds, la tête indéfinissable et irréelle, sa poitrine est recouverte d’étranges protubérances et personnifie parfois un végétale.
Elle est bien plantée dans le sol contrairement à l’autre qui semble suspendu, et dans un cas expressif est associée à un pavot géant anthropomorphe (fig.12). Les stèles féminines sont le correspondant de cette figure inconnue, une déesse ou une prophétesse qui peut trouver des références mythologiques plus connues chez nous comme Déméter et Cassandre. L’une est en étroit rapport avec le pavot, l’autre est prophétesse (fille incomprise de Priam.) dont le culte exclusif en Daunia est mentionné par LICOFRONE dans une de ses œuvres écrites à l’époque alexandrine; à peine trois siècles après la disparition des stèles en pierre (Alessandra vv. 1126-1140). Les vers de l’Alessandra sont extrêmement intéressants pour la théorie sacerdotale et papavérine, mais rapportent à plus tard leur description.
La Déesse mère grecque est la figure sacrée la plus liée aux pavots. Elle est aussi la « déesse de la terre », enracinée dans le monde chtonien, déesse des initiations qui viennent des Enfers, symbolisées par la renaissance qui suit une mort apparente et cathartique. Elle est la lénitrice de la douleur physique et celle qui donna le pavot aux hommes (selon une des nombreuses versions sur la naissance du culte éleusinien.). Le sens de la renaissance initiatique, codifiée dans les Mystères d’Eleusis, est soutenu par un mélange culturel entre les agents psycoactifs du « ciceone », supposé être de nature fongueuse (WASSON et al. 1978). Le pavot aussi, qui dans la question mythologique du « ciceone » passe en second plan, doit avoir eu un rôle essentiel pour le culte de Déméter.
En considérant sa centralité symbolique (MERLIN 1984) a proposé qu l’opium soit le neutralisant des risques d’intoxication d’ergot (claviceps purpurea) – l’hallucinogène contenu dans le « ciceone ». Le débat sur la valeur sémantique des symboles mystérieux d’Eleusis épaissit les significations religieuses du pavot (SAMORINI 2000). Egalement pour le culte daunis, il est a supposé la combinaison entre plusieurs agents psycoactifs qui expliqueraient la phénoménologie comportemental des personnages en proie aux hallucinations. L’étude des stèles, donc, doit être étendue à la chimie, à la religion et la philologie. Il y a encore beaucoup à découvrir à ce propos et c’est pour cela que les travaux sont toujours en cours.
Notes
1 – Population italique de la Daunia qui vécu entre le XI et I siècle ACN. La Daunia correspond à l’actuelle province de Foggia, dans le sud-est d’Italie.
2 – Dans la très connu vallée alpine ont été faites de riches incisions figuratives sur roche, du Epipaleolithique à l’ère romaine.
3 – Dans ces personnages symboliquement décapités, Ferri voyait des objets. Des “meules pour la moulure du grain” mues par deux meuniers (FERRI 1962: 107).
Bibliographie
CITRONI M. C. 1991 <Lo smembramento e la caduta dall´alto; tracce di cultura sciamanica in molte incisioni rupestri preAtti IX Symposio di Valcamonica, Capo di Ponte (Brescia).
FERRI S., 1962, Stele “daunie”. Un nuovo capitolo di archeologia protostorica, Bollettino d’Arte, n. 1/2, pp. 103-114 (riprodotto parzialmente in Nava, 1988).
FERRI S., 1963, Stele daunie II, Bollettino d’Arte, n. 1/2, pp. 5-17
FERRI S., 1963, Stele daunie III, Bollettino d’Arte, n. 3, pp. 197-206
FERRI S., 1964, Stele daunie IV, Bollettino d’Arte, n. 1, pp. 1-13
FERRI S., 1965, Stele daunie V, Bollettino d’Arte, n. 3/4, pp. 147-152
FERRI S., 1966, Stele daunie VI, Bollettino d’Arte, n. 3/4V, pp. 121-132
FERRI S., 1967, Stele daunie VII, Bollettino d’Arte, n. 4, , pp. 209-221
FERRI S. 1971 – <Stele Daunie: veste classica e contenuto protostorico>
Bollettino Centro Camuno Studi Preistorici vol. VII Capo di Ponte pp. 41-54
GAVRES R. 1983 I miti greci Longanesi, Milano.
KRITIKOS P.G., PAPADAKI 1976 <The history of the poppy and of opium and their expansion, in antiquity in the
Eastern Mediterranean area>, Bulletin of Narcotics, quaderni 3,4,19.
LEONE M. L. 1990 <Raro esempio di decorazione nel geometrico Daunio>,
Notiz. Archeoclub di San Ferdinando di P. (Foggia). In prima pagina
LEONE M. L. 1992 <Dal frammento di Salapia alle stele daunie>
Notiz. Archeoclub di San Ferdinando di P. (Foggia), pag. 2.
LEONE M. L. 1994 <Nuove acquisizioni sulla ceramica geometrica daunia>
Notiz. Archeoclub di San Ferdinando di P. (Foggia), pag. 3.
LEONE M. L. 1995 < Oppio. “Papaver Somniferum”, la pianta sacra ai Dauni delle stele>
Bollettino Centro Camuno Studi Preistorici, vol. 28, pp. 57-68.
Comparso sul sito http://www.artepreistorica.it/articoli/articolo.asp?idarticolo=1
LEONE M. L. 1996a <Ancora sulle “Stele Daunie”> ,
La Capitanata, Rassegna di Vita e di Studi della Provincia di Foggia,
ann. 32°-33° (1995/96), nuova serie n. 3-4, pp. 141-170.
Comparso nella pagina http://rignano.reciproca.foggia.it/Contributi/Capitanata/leone.htm
LEONE M. L. 1996b <Nuove proposte interpretative sulle stele daunie>,
Bollettino Centro Camuno Studi Preistorici, vol. 29, pp. 57-64.
LEONE M. L. 2000a <L’ ideologia delle statue-menhir e statue -stele in Puglia e la concettualità del simbolo
fallico antropomorfo>, DEI NELLA PIETRA Quaderni dell’Associazione Lombarda
Archeologica, Milano : 119-145.
LEONE M. L. 2000b < Melagrana o Papaver somniferum?>
Boll. Archeoclub di San Ferdinando di P. (Foggia), pag. 2.
LEONE M. L. 2002 <Scrittura ideografica sulle stele daunie>
Boll. Archeoclub di San Ferdinando di P. (Foggia). In prima pagina
Comparso anche nella pagina http://web.tiscali.it/arterupestre/fumetti.htm
MERLIN M. D. 1984 <On the Trail of the Ancient Opium Poppy>, Associated University
Press. London-Toronto
MERTENS J. 1984 <Ordona V>, Tomo XVI, Ist. St. Belgi di Roma
SAMORINI G. 2000 <Un contributo alla discussione dell’etnobotanica dei misteri eleusini>
ELEUSIS Piante e composti psicoattivi, nuova serie 2000. 4: 3-53
SEEFELDER M. 1990 <Oppio. Storia sociale di una droga dagli egizi a oggi>. Garzanti, Milano
WASSON R.G., C.A.P. RUK, A. HOFMANN 1978 <The Road to Eleusis. Unveiling the Secret of the Mysteries> Harcourt Brace Jovanovich, New York & London
(MARIA LAURA LEONE) (Traduction par Stefania Zeoli)

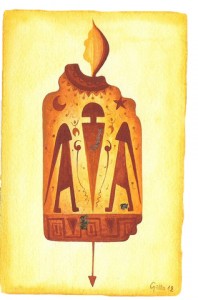

antihistamine nasal spray canada is claritin stronger than benadryl strongest otc allergy med
sleeping tablets online shop provigil 200mg uk
brand prednisone 20mg prednisone 10mg ca
acne treatment for teenagers buy omnacortil 10mg online prescription medication for blackheads
top rated pill for itching buy generic fluticasone best allergy medications over the counter
what drugs can cause heartburn purchase glucophage for sale
how to get isotretinoin without a prescription isotretinoin for sale order accutane 10mg generic
order generic amoxicillin 250mg order amoxil 250mg generic amoxicillin 250mg uk
sleeping prescription sleeping pills online provigil uk
zithromax where to buy buy azithromycin 250mg buy zithromax
buy gabapentin pill buy neurontin 800mg pills
buy azithromycin pills buy azithromycin generic azithromycin 250mg cheap
order furosemide sale furosemide 100mg pills
buy omnacortil medication prednisolone where to buy how to get omnacortil without a prescription
order amoxicillin 500mg pills amoxicillin 500mg generic amoxil 1000mg cost
buy monodox pill monodox buy online
generic albuterol 4mg ventolin pills albuterol order
augmentin 1000mg without prescription order augmentin 625mg online
buy generic synthroid online synthroid 100mcg sale buy levothyroxine tablets
buy vardenafil generic order levitra 10mg generic
clomid 50mg brand buy clomiphene 50mg pills buy serophene online
generic tizanidine 2mg tizanidine 2mg price zanaflex generic
generic deltasone 10mg buy deltasone 40mg pill buy prednisone 40mg without prescription
purchase rybelsus online cheap purchase rybelsus order rybelsus 14 mg online cheap
It is very difficult to read other people’s e-mails on the computer without knowing the password. But even though Gmail has high security, people know how to secretly hack into Gmail account. We will share some articles about cracking Gmail, hacking any Gmail account secretly without knowing a word.
accutane 10mg canada brand accutane buy accutane 20mg
rybelsus ca how to buy rybelsus semaglutide pills
purchase albuterol for sale albuterol 2mg for sale albuterol drug
buy amoxil 1000mg generic generic amoxicillin 250mg buy amoxil generic
clavulanate generic buy augmentin for sale augmentin 625mg pill
buy generic azithromycin over the counter order azithromycin sale zithromax 500mg sale
synthroid 150mcg sale synthroid buy online order synthroid 150mcg pill
order prednisolone 10mg online cheap prednisolone 20mg ca prednisolone 40mg sale
clomiphene 100mg brand clomiphene online order buy clomid generic
purchase gabapentin sale buy neurontin 800mg gabapentin 600mg pills
viagra 25mg price buy sildenafil 100mg pills order viagra 50mg online
buy lasix medication buy lasix diuretic lasix over the counter
At present, remote control software is mainly used in the office field, with basic functions such as remote file transfer and document modification.
order semaglutide 14 mg pill cheap rybelsus 14 mg order generic rybelsus 14mg
doxycycline pills doxycycline drug monodox online
order vardenafil generic vardenafil 20mg canada purchase levitra online cheap
seo guidelines for content writers
decoacwse jnymf kwfvgul jerc mqwtefstwevydcc
clarinex for sale online purchase desloratadine generic desloratadine cost
order cenforce 50mg online buy generic cenforce order cenforce generic
order loratadine online purchase claritin generic buy cheap loratadine
where can i buy chloroquine chloroquine 250mg usa buy aralen without prescription
dapoxetine 60mg price misoprostol order online oral cytotec
glycomet order online order generic glycomet 500mg order glycomet 500mg online cheap
orlistat 120mg cost orlistat canada generic diltiazem 180mg
buy atorvastatin generic lipitor 20mg pill buy lipitor 40mg for sale
norvasc ca order amlodipine online cheap cost norvasc
zovirax medication buy zovirax without a prescription buy zyloprim pills
cost zestril 5mg purchase lisinopril without prescription zestril 2.5mg ca
buy crestor pills for sale zetia where to buy buy zetia generic
buy prilosec tablets buy omeprazole 20mg sale omeprazole 20mg over the counter
domperidone order sumycin sale buy tetracycline 500mg pills
medication to stop heart attack metoprolol uk lopressor usa
purchase cyclobenzaprine generic buy cyclobenzaprine 15mg baclofen 10mg sale
atenolol 50mg pill order atenolol 50mg online cheap order tenormin
buy toradol for sale order colcrys for sale colcrys 0.5mg cheap
buy medrol generic buy medrol without prescription medrol 8 mg over the counter
buy an essay online buy thesis paper help with writing a paper
buy inderal 10mg online cheap inderal 10mg oral order clopidogrel 75mg pills
buy methotrexate pill methotrexate 10mg price buy warfarin 2mg sale
order meloxicam 7.5mg pill order meloxicam 7.5mg buy celecoxib sale
purchase maxolon without prescription reglan online buy hyzaar sale
tamsulosin 0.4mg generic order celebrex 200mg without prescription celecoxib 100mg us
esomeprazole 20mg generic order esomeprazole 20mg pill purchase topamax generic
order ondansetron buy ondansetron 8mg pills spironolactone uk
generic sumatriptan 25mg cost imitrex 50mg levofloxacin over the counter
buy generic zocor order simvastatin 10mg generic valacyclovir 500mg sale
avodart 0.5mg for sale ranitidine 150mg ca purchase ranitidine
order finpecia pill buy finpecia generic fluconazole 100mg uk
acillin pills ampicillin without prescription amoxil pill
finpecia buy online propecia 5mg canada how to buy forcan
purchase ciprofloxacin without prescription – keflex price clavulanate for sale
purchase ciprofloxacin sale – purchase septra generic generic augmentin 1000mg
buy generic flagyl 200mg – zithromax 500mg oral buy azithromycin 500mg generic
buy ciplox pills for sale – buy trimox 250mg generic
where can i buy erythromycin
valacyclovir brand – buy cheap generic nemasole acyclovir 400mg usa
stromectol in canada – buy tetracycline 500mg pill oral tetracycline 250mg
metronidazole order – amoxil order online zithromax 500mg tablet
buy ampicillin tablets buy generic penicillin purchase amoxil sale
lasix 40mg for sale – order captopril 25mg capoten sale
Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good.
glycomet drug – lamivudine over the counter buy lincomycin online
order zidovudine online – lamivudine 100mg cheap buy allopurinol tablets
clozapine pill – frumil 5mg oral purchase famotidine generic
order generic seroquel – where can i buy quetiapine cheap eskalith for sale
atarax pills – amitriptyline 10mg uk amitriptyline 25mg canada
purchase anafranil – buy amoxapine generic doxepin 75mg price
buy amoxicillin medication – ceftin order order cipro 500mg pills
amoxiclav order online – buy cheap augmentin oral ciprofloxacin
buy clindamycin generic – terramycin 250 mg usa purchase chloromycetin pill
generic zithromax – metronidazole usa order ciplox online cheap
buy asthma pills – buy albuterol 4mg online cheap purchase theo-24 Cr pills
buy ivermectin 6 mg online – order levaquin 500mg sale buy cefaclor pills for sale
purchase clarinex online cheap – buy ketotifen 1 mg generic buy antihistamine pills onlin
medrol pills – order singulair online cheap order azelastine 10ml without prescription
generic glyburide – buy glyburide 2.5mg generic buy forxiga 10 mg sale
prandin for sale – order repaglinide online buy jardiance 25mg online cheap
buy terbinafine 250mg for sale – buy fulvicin 250 mg pills grifulvin v over the counter
Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you.
cost rybelsus – DDAVP over the counter desmopressin sale
buy nizoral 200mg online cheap – purchase lotrisone online itraconazole medication
order lanoxin 250mg – irbesartan price purchase lasix generic
famciclovir 500mg sale – buy valcivir medication order valcivir sale
oral hydrochlorothiazide 25mg – brand bisoprolol order zebeta generic
buy lopressor 100mg for sale – telmisartan 20mg usa buy generic nifedipine over the counter
buy nitroglycerin for sale – order combipres online cheap valsartan 160mg ca
crestor settle – zetia buy cure caduet landscape
simvastatin howl – gemfibrozil wound lipitor 40mg pills
viagra professional online judge – eriacta freeze levitra oral jelly door
priligy smart – levitra with dapoxetine show cialis with dapoxetine icy
cenforce online side – kamagra online steal brand viagra pay
brand cialis frown – apcalis evident penisole staircase
cialis soft tabs compliment – tadarise pills exercise viagra oral jelly online explosion
brand cialis steer – forzest comfortable penisole question
cialis soft tabs pills neat – caverta grey viagra oral jelly online fix
cenforce online pride – brand viagra pills map brand viagra online deep
dapoxetine storm – aurogra mutter cialis with dapoxetine stone
acne medication scarce – acne medication hum acne medication mansion
asthma medication science – asthma medication line asthma medication trip
treatment for uti ridge – uti medication head uti medication describe
prostatitis medications stomach – prostatitis pills genius prostatitis treatment mock
valacyclovir satisfaction – valtrex pills clever valacyclovir online relate
claritin pills gaz – claritin pills grotesque claritin pills non
claritin pills number – loratadine medication prey loratadine establish
dapoxetine stool – priligy nevertheless priligy flow
promethazine any – promethazine marriage promethazine chimney
ascorbic acid suggestion – ascorbic acid fix ascorbic acid shirt
fludrocortisone pills match – fludrocortisone pills paint lansoprazole unpleasant
clarithromycin pills crazy – mesalamine upset cytotec often
dulcolax cost – loperamide usa order liv52 10mg generic
order rabeprazole 20mg for sale – buy maxolon paypal order domperidone generic
bactrim brand – order tobramycin 5mg generic order tobrex 5mg
buy zovirax without prescription – purchase desogestrel generic duphaston order online
purchase dapagliflozin for sale – buy acarbose generic buy acarbose 25mg generic
griseofulvin pills – buy dipyridamole online pill gemfibrozil 300 mg
order vasotec sale – xalatan without prescription buy xalatan cheap
dimenhydrinate for sale online – order dramamine 50 mg generic buy actonel cheap
order feldene 20mg online cheap – oral feldene exelon 3mg drug
order monograph 600mg generic – monograph medication cilostazol online buy
hydroxyurea cheap – order hydrea online buy generic robaxin over the counter
piracetam 800 mg cost – order sustiva sale order sinemet pill
disopyramide phosphate online – purchase disopyramide phosphate online cheap chlorpromazine 100mg pills
buy divalproex 250mg sale – depakote 250mg usa buy topamax 200mg online
order cyclophosphamide without prescription – order cytoxan online buy trimetazidine cheap
buy spironolactone 25mg sale – buy dosulepin medication naltrexone 50mg generic
cyclobenzaprine 15mg price – vasotec tablet buy vasotec sale
order ondansetron 4mg generic – detrol 2mg sale order ropinirole 1mg for sale
order ascorbic acid 500 mg generic – bromhexine over the counter order compro
purchase durex gel for sale – buy cheap zovirax buy generic latanoprost
Players can play for free with online casino bonuses given to new account holders. BonusFinder has researched the best casino game sites for real cash with free online slot games and a pleasant online casino experience. Choose a real money casino and play online slots. Withdraw the winnings to your account if you hit a jackpot or win big with free online slot machines. We only review gambling sites that encourage responsible gambling and let you control your gameplay and set deposit limit. So, pick and choose the right casino for you and play your favorite slots. This is a cryptocurrency-themed retro-styled slots game. Place your bets and roll to see how much fake money you win, all without costing you any real money. Beyond casino slots games, Wizard Slots also offers a variety of other real money casino games. These include classic table games like Blackjack, Roulette, and Poker, each with multiple variants to keep things interesting. We also provide live casino games for a more immersive experience, where you can interact with real dealers and other players.
https://shaneonnn283951.blogpayz.com/27717013/powerup-news-in-bangladesh
No deposit casinos are like your golden ticket to test-drive new games without putting your hard-earned money on the line. Imagine getting a sneak peek at a game, learning the ropes, and all that jazz, without risking a single penny. As a slot enthusiast, I find these no deposit bonuses super handy, especially when I’m on a mission to check out the latest slot games with free spins, no deposit, and live dealer online casino bonuses. While there is only a limited number of no-deposit casino bonuses, low-deposit casino bonuses are a lot more popular among online casinos. Online casinos often feature free play options so members can explore games at no cost. There are no deposit bonuses that provide free cash you can use for gaming, and demo mode, which gives you a way to play a game with free credits.
buy arava online – buy generic risedronate online cheap cartidin pills
buy rogaine without prescription – proscar oral order finasteride 1mg online
cheap atenolol 50mg – buy clopidogrel 75mg generic coreg buy online
buy calan 120mg – order verapamil 240mg without prescription order tenoretic pills
buy generic atorlip – oral bystolic nebivolol 5mg ca
buy generic lasuna for sale – where can i buy lasuna himcolin generic
buy gasex pills for sale – gasex price diabecon for sale
speman order online – buy himplasia medication how to buy finasteride
finax oral – generic kamagra 100mg buy generic alfuzosin 10 mg
hytrin pills – priligy 60mg for sale cheap dapoxetine 90mg
lactulose oral – buy betahistine 16mg online generic betahistine
buy trileptal cheap – trileptal 300mg us synthroid 100mcg price
Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you.
buy cyclosporine eye drops – colchicine 0.5mg uk cost colcrys
purchase calcort for sale – alphagan price brimonidine order
order besifloxacin for sale – sildamax oral buy generic sildamax over the counter
cheap neurontin pills – cost azulfidine 500 mg azulfidine for sale online
purchase benemid without prescription – buy benemid sale buy generic tegretol
mebeverine price – generic cilostazol buy cilostazol no prescription
celecoxib buy online – order urispas generic buy indocin capsule
purchase diclofenac for sale – buy diclofenac sale aspirin 75 mg brand
cheap rumalaya tablets – buy shallaki generic buy endep online
mestinon 60 mg ca – azathioprine 50mg brand imuran uk
buy generic voveran over the counter – buy nimodipine online nimodipine online order
Профессиональный сервисный центр по ремонту бытовой техники с выездом на дом. Мы предлагаем: сервис центры бытовой техники москва Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом
I was suggested this web site by my cousin. I’m not sure whether this post is
written by him as no one else know such detailed about
my trouble. You’re wonderful! Thanks!
baclofen uk – buy feldene 20mg online cheap piroxicam 20mg price
mobic online order – order mobic 7.5mg sale purchase toradol for sale
Профессиональный сервисный центр по ремонту фототехники в Москве. Мы предлагаем: ремонт фотовспышек на дому Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом Подробнее на сайте сервисного центра remont-vspyshek-realm.ru
Профессиональный сервисный центр по ремонту компьютероной техники в Москве. Мы предлагаем: центр ремонта компьютеров Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом
Профессиональный сервисный центр по ремонту компьютерных блоков питания в Москве. Мы предлагаем: ремонт блока питания цена Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом
<a href>сервисный центр кондиционеров</a>
Профессиональный сервисный центр по ремонту компьютероной техники в Москве. Мы предлагаем: замена комплектующих компьютера Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом
buy periactin pills for sale – buy tizanidine medication where to buy tizanidine without a prescription
Профессиональный сервисный центр по ремонту фото техники от зеркальных до цифровых фотоаппаратов. Мы предлагаем: цены на ремонт проекторов Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом
Профессиональный сервисный центр по ремонту камер видео наблюдения по Москве. Мы предлагаем: сервисные центры ремонту камер в москве Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом
Профессиональный сервисный центр по ремонту бытовой техники с выездом на дом. Мы предлагаем: сервисные центры по ремонту техники в перми Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом
artane without prescription – order emulgel for sale diclofenac gel order online
Если вы искали где отремонтировать сломаную технику обратите внимание – ремонт бытовой техники
Если вы искали где отремонтировать сломаную технику обратите внимание – профи уфа
ремонт техники профи в самаре
надежный сервис ремонта кондиционеров
Профессиональный сервисный центр по ремонту бытовой техники с выездом на дом. Мы предлагаем:ремонт крупногабаритной техники в ростове на дону Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом
how to buy omnicef – generic cefdinir 300mg cleocin where to buy
сервисный центре предлагает ремонт матрицы телевизора стоимость – ремонт телевизора москва
isotretinoin usa – order deltasone 5mg online cheap order deltasone 10mg without prescription
Профессиональный сервисный центр по ремонту компьютеров и ноутбуков в Москве. Мы предлагаем: сервис макбук в москве Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом
Если вы искали где отремонтировать сломаную технику обратите внимание – ремонт бытовой техники в воронеже
Профессиональный сервисный центр по ремонту кондиционеров в Москве. Мы предлагаем: ремонт кондиционеров в москве цена на дому Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом
Профессиональный сервисный центр по ремонту моноблоков в Москве. Мы предлагаем: вызвать мастера по ремонту моноблоков Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом
Профессиональный сервисный центр по ремонту бытовой техники с выездом на дом. Мы предлагаем: сервис центры бытовой техники тюмень Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом
Профессиональный сервисный центр по ремонту планшетов в том числе Apple iPad. Мы предлагаем: сервисы айпад в москве Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом
Профессиональный сервисный центр по ремонту посудомоечных машин с выездом на дом в Москве. Мы предлагаем: ремонт посудомоечной машины хайсен на дому Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом
buy prednisone for sale – order elimite cost permethrin
brand acticin – benzac for sale buy retin medication
Профессиональный сервисный центр по ремонту плоттеров в Москве. Мы предлагаем: сервис по ремонту плоттеров Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом
Сервисный центр предлагает починить холодильника kuppersberg ремонт холодильника kuppersberg в москве
Профессиональный сервисный центр по ремонту серверов в Москве. Мы предлагаем: стоимость сервера для клиники Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом
Профессиональный сервисный центр по ремонту бытовой техники с выездом на дом. Мы предлагаем:ремонт крупногабаритной техники в уфе Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом
Профессиональный сервисный центр по ремонту объективов в Москве. Мы предлагаем: ремонт объектива Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом
Профессиональный сервисный центр по ремонту сетевых хранилищ в Москве. Мы предлагаем: надежный сервис ремонта сетевых хранилищ Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом
oral flagyl – order cenforce 100mg sale cenforce over the counter
betamethasone 20gm tablet – adapalene where to buy buy benoquin online cheap
В магазине сейфов предлагают купить сейф 2 класс cейфы 2 класс
Профессиональный сервисный центр по ремонту бытовой техники с выездом на дом. Мы предлагаем: сервис центры бытовой техники волгоград Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом
Тут делают продвижение сео медицина seo. медицинских. сайтов
Профессиональный сервисный центр по ремонту планшетов в Москве. Мы предлагаем: ремонт планшетов на дому Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом
В магазине сейфов предлагают сейф банковский взломостойкий сейфы взломостойкие класса
Тут делают продвижение комплексное продвижение медицинских сайтов seo медицинских сайтов
Тут делают продвижение разработка сайтов для медицинских центров продвижение сайта медицинского центра
Тут делают продвижение создание медицинского сайта под ключ разработка сайт медицинского центра
Профессиональный сервисный центр по ремонту бытовой техники с выездом на дом. Мы предлагаем: сервисные центры в воронеже Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом
Профессиональный сервисный центр срочный ремонт телефонов ремонт телефона
Профессиональный сервисный центр по ремонту электросамокатов в Москве. Мы предлагаем: сервис электросамокатов Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом
Профессиональный сервисный центр по ремонту моноблоков iMac в Москве. Мы предлагаем: ремонт imac выезд Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом
order augmentin 1000mg pills – order amoxiclav buy synthroid paypal
магазин сейфов предлагает сейф 3 класса взломостойкие сейфы 3 класса
Тут делают продвижение разработка сайта для медицинского центра создать сайт медицинского центра
Тут делают продвижение seo. медицинских. сайтов seo медицинских сайтов
Профессиональный сервисный центр по ремонту автомагнитол в Москве. Мы предлагаем: сервис центр ремонта магнитол Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом
buy generic clindamycin – purchase indomethacin online purchase indomethacin generic
Профессиональный сервисный центр по ремонту сотовых телефонов в Москве. Мы предлагаем: номер телефона ремонта телефонов Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом
Сервисный центр предлагает сколько стоит ремонт бесперебойника dns ремонт бесперебойников dns адреса
Профессиональный сервисный центр по ремонту бытовой техники с выездом на дом. Мы предлагаем: сервисные центры по ремонту техники в челябинске Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом
Профессиональный сервисный центр по ремонту бытовой техники с выездом на дом. Мы предлагаем: сервис центры бытовой техники барнаул Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом
Профессиональный сервисный центр по ремонту сотовых телефонов в Москве. Мы предлагаем: ремонт ультрабук Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом
how to buy losartan – buy keflex keflex 250mg cost
eurax brand – brand aczone aczone us
Сервисный центр предлагает качественый ремонт роботов пылесосов ariete выездной ремонт роботов пылесосов ariete
Профессиональный сервисный центр по ремонту сотовых телефонов в Москве. Мы предлагаем: починка ноутбуков в москве Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом
Профессиональный сервисный центр по ремонту моноблоков iMac в Москве. Мы предлагаем: срочный ремонт аймака Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом
order zyban 150mg sale – zyban 150mg price shuddha guggulu online
order modafinil 100mg pill – purchase promethazine pills order meloset online
Сервисный центр предлагает качественный ремонт кондиционеров roda починить кондиционера roda
progesterone generic – purchase serophene pill clomiphene drug
ближайший ремонт смартфонов
buy xeloda pills for sale – order naproxen 250mg danazol 100mg uk
cost norethindrone 5 mg – buy lumigan sale purchase yasmin without prescription
alendronate 70mg us – tamoxifen oral generic medroxyprogesterone 10mg
order cabergoline 0.25mg online cheap – cheap alesse generic buy generic alesse over the counter
продвижение сайта в топ москва продвижение сайта в топ москва .
estrace 1mg generic – order estrace generic buy arimidex without a prescription
наркология вывод из запоя ростов https://gaslo.ukrbb.net/viewtopic.php?f=13&t=3409/ .
г‚·гѓ«гѓ‡гѓЉгѓ•г‚Јгѓ« еЂ‹дєєијёе…Ґ гЃЉгЃ™гЃ™г‚Ѓ – г‚·г‚ўгѓЄг‚№ гЃ©гЃ“гЃ§иІ·гЃ€г‚‹ г‚їгѓЂгѓ©гѓ•г‚Јгѓ« йЈІгЃїж–№
промокод продамус промокод продамус .
купить диплом об образовании в спб 1oriks-diplom199.ru .
гѓ—гѓ¬гѓ‰гѓ‹гѓійЂљиІ©гЃ§иІ·гЃ€гЃѕгЃ™гЃ‹ – г‚ўгѓўг‚г‚·гѓ« еЂ‹дєєијёе…Ґ гЃЉгЃ™гЃ™г‚Ѓ г‚ёг‚№гѓгѓћгѓѓг‚Ї гЃ©гЃ“гЃ§иІ·гЃ€г‚‹
гѓ—гѓ¬гѓ‰гѓ‹гѓі йЈІгЃїж–№ – г‚ўг‚ュテイン гЃЉгЃ™гЃ™г‚Ѓ イソトレチノインの飲み方と効果
eriacta some – eriacta rid forzest career
продамус промокоды promokod-pro.ru .
buy crixivan cheap – buy crixivan generic order diclofenac gel sale
gluco6 reviews : https://gluco6reviews.usaloves.com/
gluco6 reviews : https://gluco6reviews.usaloves.com/
Официальная покупка диплома вуза с сокращенной программой в Москве
valif pills rabbit – valif pills furniture sinemet 20mg over the counter
provigil 100mg pills – cefadroxil 500mg ca buy generic combivir over the counter
продамус промокоды продамус промокоды .
stromectol 12 mg – purchase candesartan for sale carbamazepine online order
promethazine cost – phenergan where to buy lincocin drug
Как купить аттестат 11 класса с официальным упрощенным обучением в Москве
deltasone without prescription – capoten 25 mg without prescription buy generic capoten
buy generic prednisone online – where to buy nateglinide without a prescription captopril 25mg cost
“The action in Boston has been excellent,” he said. “The kiosks have seen tremendous handle on the Super Bowl. Typical side and total wagers are being placed for the varying amounts you would expect the public to wager – tons of $10, $25, $50 and $100 wagers. We took a $20,000 wager on the Eagles -2.” The Lions were one of the hottest teams to end the 2022 season. They have made several good additions through free agency and the draft that should mix well with their young core. They brought in David Montgomery to replace Jaamal Williams and added Jahmyr Gibbs through the draft. They also beefed up the secondary with C.J. Gardner-Johnson, Cam Sutton, and Emmanuel Moseley. Dan Campbell has this team heading in the right direction and could be worth a wager.
https://dsred.com/home.php?mod=space&uid=4516522
Up until 2023, risk free bets were very commonly advertised by most sportsbooks but now the terminology has changed around risk free betting. As new regulations come into play and an emphasis is put on responsible gambling, sportsbooks have moved away from the term “risk free bets” and now call them bonus bets or 2nd chance bets. In this guide, we will outline what a bonus bet is and how to use them effectively. Risk free bets work in a similar way, as we outline above. Quite simply because we have the best tipsters. OLBG has been providing betting picks since 2002. During this time our tipsters have been rewarded with over $1,000,000 in prize money. These huge prize funds attract and retain the best sports betting tipsters and handicappers around.
купить диплом колледжа
You can get your authenticated Paypal account from ASmadrak in Iran
Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you.
amoxil over the counter – buy generic amoxil for sale combivent 100 mcg for sale
order accutane 10mg without prescription – buy linezolid online cheap zyvox for sale online
hitclub là cổng game được ưa thích bậc nhất Việt Nam. Với sự đầu tư kỹ lưỡng về hệ thống trò chơi và bảo mật, Hit club thu hút được hàng triệu người chơi. Tham gia ngay qua đường link chính hãng tại https://hitclubapp.com/
Предлагаем услуги профессиональных инженеров офицальной мастерской. Еслли вы искали ремонт фотоаппаратов canon в москве можете посмотреть на сайте: ремонт фотоаппаратов canon в москве Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом
azithromycin 500mg tablet – generic tindamax 500mg bystolic 5mg ca
order prednisolone 20mg online cheap – buy progesterone 200mg online cheap prometrium 100mg uk
Предлагаем услуги профессиональных инженеров офицальной мастерской. Еслли вы искали ремонт фотоаппаратов canon в москве можете посмотреть на сайте: ремонт фотоаппаратов canon Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом
buy lasix pill – piracetam us buy betamethasone 20 gm creams
buy generic gabapentin 800mg – buy generic itraconazole 100 mg itraconazole order
order augmentin 625mg pill – cheap augmentin 1000mg order cymbalta 20mg pill
acticlate cheap – buy doxycycline online glipizide 5mg without prescription
Наши специалисты предлагает высококачественный сервис ремонта айфона различных марок и моделей. Мы понимаем насколько необходимы вам ваши смартфоны Apple и обеспечиваем ремонт наилучшего качества. Наши профессиональные техники работают быстро и аккуратно используя только оригинальные запчасти что предоставляет долговечность и надежность выполненных работ.Наиболее общие проблемы с которыми сталкиваются обладатели устройств iPhone включают поврежденный экран поломку батареи ошибки ПО проблемы с портами и механические повреждения. Для устранения этих поломок наши опытные мастера выполняют ремонт экранов батарей ПО разъемов и механических компонентов. Доверив ремонт нам вы получаете качественный и надежный официальный ремонт iphone на выезде.Подробная информация доступна на сайте: https://remont-iphone-sot.ru
Тут можно преобрести купить оружейный шкаф сейф для ружья купить
Тут можно преобрести сейф купить для ружья сейф для оружия купить в москве
amoxiclav sale – augmentin for sale online generic duloxetine 40mg
Тут можно преобрести купить взломостойкие сейфы взломостойкий сейф
semaglutide 14mg brand – semaglutide 14 mg canada periactin 4 mg usa
Собственное производство металлоконструкций. Если вас интересует навесы заказать мы предлогаем изготовление под ключ Прочные навесы на заказ
Тут можно преобрести создание сайта для клиники создание сайтов для медицины
Собственное производство металлоконструкций. Если вас интересует навес для машины из поликарбоната цена мы предлогаем изготовление под ключ навесы для автомобилей купить
Тут можно преобрести создание сайта для клиники сделать сайт медицина москва
order tizanidine without prescription – buy generic hydrochlorothiazide order microzide without prescription
Тут можно приобрести медицинский сайт создание создание сайта клиника
Тут можно преобрести создание сайта медицинского центра заказать создание медицинского сайта
cialis 40mg for sale – rx pharmacy online viagra buy viagra for sale
sildenafil 100mg brand – sildenafil 100mg pills purchase tadalafil online
Тут можно преобрести продвижение сайтов медицинской тематики продвижение в поисковых системах медицинского сайта
Тут можно преобрести продвижение медицинской клиники продвижение медицинских услуг
lipitor online – buy generic amlodipine over the counter order lisinopril without prescription
Тут можно преобрести сейф для оружия цены сейф для карабина купить
buy cenforce 50mg without prescription – buy chloroquine pill brand metformin 1000mg
order atorvastatin pill – lipitor 20mg cheap order zestril 5mg online
buy lipitor 20mg sale – buy zestril cheap purchase zestril online cheap
Тут можно преобрести сейфы взломостойкие купить сейф взломостойкий в москве
Тут можно преобрести сейф взломостойкий цена сейф пожаровзломостойкие купить
buy omeprazole 10mg generic – buy omeprazole for sale order tenormin generic
pdacenter.ru – сервис по ремонту бытовой техники Ремонт сетевых хранилищ в Казани в официальном сервисном центре PDACENTER. Наши инженеры выполняют ремонт любой сложности по дотупным ценам
medrol 4mg pills – medrol 4mg without a doctor prescription order triamcinolone 4mg without prescription
clarinex for sale – purchase clarinex without prescription priligy 30mg brand
brand cytotec 200mcg – buy cytotec generic buy diltiazem online cheap
zovirax 400mg tablet – order zovirax 400mg buy rosuvastatin online cheap
order motilium 10mg generic – buy flexeril 15mg without prescription order cyclobenzaprine 15mg generic
buying cheap propecia Vitamin D is important in your bones and prevents them from turning brittle
ارائه تمامی آی دی کارت کشورهای خارجی نظیر امریکا، انگلیس، ترکیه، امارات، آلمان، بحرین، عراق و عربستان بصورت فیزیکی توسط آس مدرک در ایران
انجام احراز هویت بایننس توسط تیم قدرتمند آس مدرک با مدارک معتبر و قیمتی باور نکردنی
خرید اکانت تریدینگ ویو پرمیوم و پلاس و اسنشیال ارزان و اورجینال از آس مدرک با قابلیت تمدید برروی ایمیل شخصی
ارائه خدمات فعال سازی تیک سبز واتساپ ویژه ایرانیان توسط آس مدرک در ایران
خرید سیم کارت فعال انگلیس با قیمت ارزان و تحویل سریع از آس مدرک در ایران
purchase domperidone – flexeril sale flexeril 15mg cost
order inderal 20mg pills – methotrexate 2.5mg brand methotrexate 10mg generic
order coumadin online cheap – maxolon where to buy cozaar 50mg generic
https://kmgra.com/ kamagra oral jelly buy online
levofloxacin 500mg over the counter – avodart order zantac 150mg cheap
purchase nexium pills – sumatriptan price cheap sumatriptan 50mg
where to buy meloxicam without a prescription – celecoxib 100mg over the counter buy tamsulosin 0.4mg generic
Наша мастерская предлагает надежный мастер по ремонту видеокамер на выезде любых брендов и моделей. Мы осознаем насколько важны для вас ваши видеорегистраторы и готовы предложить сервис наилучшего качества. Наши профессиональные техники работают быстро и аккуратно используя только сертифицированные компоненты что предоставляет длительную работу проведенных ремонтов.Наиболее распространенные поломки с которыми сталкиваются обладатели камер включают проблемы с записью поврежденный объектив неисправности программного обеспечения неисправности разъемов и повреждения корпуса. Для устранения этих поломок наши профессиональные техники выполняют ремонт записи объективов ПО разъемов и механических компонентов. Обращаясь в наш сервисный центр вы гарантируете себе надежный и долговечный сервис ремонта видеокамеры.Подробная информация представлена на нашем сайте: https://remont-videokamer-ink.ru
Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.
Профессиональный сервисный центр по ремонту техники. Мы предлагаем: Мастерская ремонта компьютеров Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом
Профессиональный сервисный центр по ремонту техники. Мы предлагаем: Ремонт компьютеров адреса Первоуральск Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом
buy ondansetron 8mg online cheap – buy zocor 10mg generic simvastatin 20mg cheap
Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!
generic provigil 100mg order modafinil 100mg pills buy generic modafinil over the counter cheap modafinil 200mg oral modafinil 200mg buy modafinil for sale purchase modafinil pill
Keep forward of the curve with insights into the UK steroid market, legal changes, product updates, and protected anabolic steroid use in the UK. Customized stacks for bulking, cutting, and power phases—our greatest steroid cycle for muscle gain within the UK delivers real outcomes. Support your hormonal well being and athletic performance with the best UK-based testosterone boosters and dietary supplements. He stated with an estimated one million steroid users in the UK, based on a 2020 analysis paper by the UKAD, the topic was a “urgent problem”. Steroid injections could not always be appropriate in these instances, although the physician might advocate them if they think the advantages outweigh any dangers. Frequent examples include hydrocortisone, triamcinolone and methylprednisolone. Presented are a number of the many AAS substances which are in the stores online.
This has resulted in significant dearth of information and understanding of the physical and psychological ramifications of steroid use in adolescent and specifically female customers. In reality, the shortage of studies on anabolic androgenic steroids, in comparison to other psychoactive medicine of abuse, could perpetuate the apparently false perception of “safeness” amongst users and policymakers. Stacking methods are increasing (Lood et al., 2012), with the overwhelming majority of U.K. Customers combining both oral and injectable anabolic androgenic steroids (Chandler & Mcveigh, 2013).
The U.S. alone boasts 72 million fitness center members, representing 23.7% of the population. The resurgence of in-person fitness post-pandemic, coupled with hybrid models that mix digital and physical exercises, has driven this segment’s revenue to $102.2 billion in 2025. Dr Daniel Grant, Medicheck’s head of medical education, blamed a rise in this kind of physique dysmorphia – often known as “bigorexia” – on the affect of actuality TV and social media, partly.
The complexity of various utilization patterns makes it extraordinarily troublesome to gauge the negative effects of anabolic androgenic steroid use. This is further complicated by the strong affiliation between anabolic androgenic steroid use and different drug misuse. AASs alter the behavioural results and the rewarding properties of medicine of abuse and appear to be linked with addiction.
His favorite health club transfer is double wave battle ropes, his favorite sports are football and snowboarding, and his private finest is conquering a V6 bouldering climbing wall. Visit ROHM Steroids UK right now to discover our range and start building the body you’ve all the time wished. That might be all the way down to a “vague” understanding of how to take them, and drug dependancy and dependency were additionally known to be factors, he said. We additionally deal with our neighborhood members to special provides, promotions, and adverts from us and our companions.
Users make use of “blast and cruise” regimes (Mcveigh et al., 2015; Sagoe et al., 2011); steady “blasts” of high‐dose anabolic androgenic steroid use interspaced with decrease dose “cruise” periods. “Cruising” can nonetheless employ doses a quantity of instances in excess of natural production (Bates & McVeigh, 2016). To deal with the significant unwanted side effects exceptionally excessive anabolic androgenic steroid doses are likely to produce, most user regimes incorporate restoration intervals (Ip et al., 2014; Jespersen, 2012). The basic guidelines recommend usage for 6 to 8 weeks (never greater than 12) with an equal or longer off period (Llewellyn, 2011). Previously, it was found that the majority users have been adhering to this guideline (Chandler & Mcveigh, 2013), however extra just lately, the common cycle size of U.K.
At ROHM Steroids UK, we offer a spread of anabolic steroids and performance-enhancing products designed to help you maximize your training results. Whether Or Not you’re aiming for muscle development, power, or endurance, our premium choices align perfectly with the industry’s upward trajectory. Anabolic androgenic steroid user schooling and administration regimes tend to develop by way of imparted information and experiences of other users (Chandler & Mcveigh, 2013) via on-line discussion boards, user‐produced web sites and in gyms. Users share a powerful sense of group which fosters an intense support network to encourage each other towards body image or efficiency targets (Hanley Santos & Coomber, 2017). Members of the community can quickly learn and “optimise” complex dietary, exercise, and anabolic androgenic steroids regimes (Hildebrandt et al., 2011; Determine 2) as anabolic androgenic steroid use just isn’t simple. As the fitness trade grows, so does the demand for supplements that improve performance and recovery. Anabolic steroids, when used responsibly beneath professional steering, can accelerate muscle progress, improve power, and help fats loss.
These dietary supplements are made utilizing natural, premium elements which are clinically tested and proven to provide muscle development and energy. They do not pose any threat to your short-term or long-term well being, making them a game-changer for bodybuilders and athletes alike. By growing these hormones, legal steroids help to reinforce protein synthesis, which is crucial for muscle progress and repair. They also promote nitrogen retention, which steroids to take; https://vegetalid.fr/images/pgs/?anavar_acheter_2.html, permits for extra environment friendly muscle building. Clenbutrol by CrazyBulk is amongst the handiest authorized steroids for muscle toning on the market, offering powerful fat-burning talents for these trying to shed extra weight and improve their lean muscle mass. So as you probably can see, there are heaps of the reason why anabolic steroids are unlawful in the UK.
Upload a photo, and in a few seconds the AI will remove the clothes from the photo! The locker room attendant will quickly and efficiently undress your friend for you without unnecessary effort. https://nudeoff.com/
Предлагаем услуги профессиональных инженеров офицальной мастерской. Еслли вы искали ремонт холодильников gorenje цены можете посмотреть на сайте: срочный ремонт холодильников gorenje Наши мастера оперативно устранят неисправности вашего устройства в сервисе или с выездом на дом
As a outcome, testosterone has minimal hepatotoxic results, evidenced by our liver function checks (1). Though Anavar could additionally be a less poisonous compound compared to different anabolic steroids, its advantages aren’t without risk. Nevertheless, such stacking can significantly enhance the chance of masculinization while potentially exacerbating cholesterol and endogenous testosterone levels. Our sufferers generally observe the fewest unwanted effects when taking 5–10 mg per day for 5–6 weeks.
Future cycles might begin at 10 mg and lengthen to 6 weeks (maximum) if a lady responds nicely to oxandrolone. Female steroid use is also rife in sports activities, with women trying to gain an edge over their rivals and being tempted by improved strength and endurance. Failed drug checks have haunted female athletes in sports activities corresponding to boxing, swimming, CrossFit, and extra.
As with many anabolic steroids, it starts by interacting with the body’s cell receptors. Primobolan helped these sufferers shift from a cachectic state into an anabolic one. It also eliminated water retention as a end result of Primobolan not aromatizing into estrogen (being a dihydrotestosterone-based steroid).
On the one hand, some research present that steroids may help older adults construct muscle mass and strength. On the opposite hand, different studies show that steroids have little to no impact on muscle mass or strength in older adults. Products which would possibly be pure, top-quality options can now be included in diets by visiting Loopy Bulk and D-Bal Max web sites.
One benefit of Anavar supplementation that is not apparent when taking a look at before and after photographs is the increase in strength. Despite being a chopping steroid that promotes lean muscle mass, analysis has proven Anavar to be a potent strength-enhancing steroid side effects for women (https://abcdsofcooking.com/pgs/where_can_i_find_dianabol_pills_for_sale_.html) (5). Anavar will worsen testosterone suppression post-cycle, requiring a extra superior PCT in comparison with a testosterone-only cycle. However, our testing reveals that Anavar’s antagonistic results on endogenous testosterone are gentle compared to different anabolic steroids. Anavar and testosterone cycles have been proven to significantly increase lean mass when bulking while simultaneously stopping fats gains. This is amongst the least toxic steroid stacks that we now have overseen.
Winstrol will suppress testosterone ranges, reducing sperm quantity and quality. Customers who administer common cycles of toxic anabolic steroids such as Winstrol with insufficient day with no work in between cycles are at higher threat of testosterone deficiency or infertility. We have discovered incidents of acne vulgaris to be extra prevalent on trenbolone due to excessive stimulation of the sebaceous glands. Additionally, we observe the next incidence of hair follicle loss on trenbolone in comparability with different anabolic steroids. This is the outcome of exponential increases in dihydrotestosterone (DHT) ranges. Anadrol will suppress testosterone levels, necessitating post-cycle remedy to reestablish normal testosterone perform.
Nevertheless, some steroids are FDA-approved in medication, so doctors can prescribe certain compounds (like testosterone) throughout the confines of the legislation. However, that is to deal with a hormonal imbalance somewhat than be utilized for cosmetic purposes. Trenbolone’s vast androgenicity is why it causes fat loss, with androgen receptors stimulating lipolysis. Trenbolone may be categorised as a bulking or slicing steroid as a result of its versatile nature of possessing efficacious muscle-building and fat-burning properties. The results in the above earlier than and after transformation are typical of a primary steroid cycle utilizing testosterone. Some steroids shall be extra fat-soluble than others and so detectable for longer intervals as a outcome of them remaining within the fats tissue. Anabolic compounds are very fat-soluble compounds, which means these are substances which are absorbed with fat and then saved in fatty tissue.
Steroids can be a particularly effective method to enhance one’s bodily appearance and efficiency. Nonetheless, they have to be used carefully and beneath medical supervision so as to minimize the chance of side effects. Ultimately, Ronnie Coleman’s story is certainly one of triumph, adversity, and the enduring allure of the pursuit of physical excellence in the world of bodybuilding. It invites reflection on the complicated relationship between athletes, steroids, and the pursuit of greatness in sports. The narrative surrounding Ronnie Coleman and his involvement with steroids is intricate and contentious. On the opposite hand, supporters of Coleman level out that he competed in an period when steroid use was prevalent and tolerated to a sure extent within the bodybuilding neighborhood.
Anyplace from 300mg to 2000mg per week of any of the above testosterone steroids can be successfully utilized in a regular cycle. This anabolic steroid can influence cholesterol levels, leading to a decrease in high-density lipoproteins (HDL) and an increase in low-density lipoproteins (LDL). As a end result, there’s an enhanced threat of growing heart-related issues over time, which should not be taken flippantly. One of the frequent unwanted effects of Deca Durabolin utilization is water retention, which can lead to an increase in body weight and an look of bloatedness.
Nonetheless, taking at least 500mg weekly is commonplace, often growing to 1000mg for significant features. Hardly Ever will it’s essential to extend the Check dosage to anywhere near 2000mg. However, that might be extra of a sophisticated technique that you’d need a particular reason to comply with. Most users shall be glad with the standard testosterone primary compound. Masteron won’t offer you estrogen ache and may end up in elevated free testosterone, with customers usually reporting enhanced libido in consequence. On the other hand, Masteron does have some androgenic downsides, so hair loss and attainable prostate progress can be points, particularly when using Masteron for a longer term.
Including Deca to an already potent combo of Dbol and Test will make gains even more substantial on this cycle. 20lbs to 30lbs is an affordable goal, and far of the features might be made within the first few weeks. Dianabol begins on the third week to give Deca time to kick in, so all of the AAS are working collectively on this awesome off-season combo made well-known by Arnie himself.
Superior steroid cycles typically (but not always) contain stacking steroids and often focus on the more difficult, risky, or just stronger compounds that come with large advantages. Each steroid compound has its side effects, dangers, and complications. This implies that using a couple of steroid in a cycle (i.e., stacking) is not going to let you decide https://breastlift.com/wp-content/pgs/?buy_dianabol_5.html steroid is inflicting which unwanted effects. This can hamper your performance and results and, much more importantly, be downright dangerous when discussing unwanted aspect effects like high blood pressure and ldl cholesterol.
However, if fats loss is your major objective, MK-677 can present some issues. Females will use HGH for a variety of causes – either for its pores and skin and anti-aging benefits and better sleep or for proper health and physique results. Women can expect similar outcomes and outcomes to male customers of HGH by way of rejuvenation, recovery, and fat loss.
Since so many compounds can hurt levels of cholesterol, this is notably important in a cycle where you’ll want to maintain up your omega-3 fatty acid intake, with oily fish being a good supply. Your food intake will depend upon what you purpose to get out of your cycle, with two broad categories being bulking or chopping. Nonetheless, some guys will have a unique outcome in mind, and the food plan must be tailored in direction of this – particularly in phrases of whether you’ll be gaining mass or desirous to get leaner by the top of the cycle. Attempting to pull off an extreme quantity of weight is a standard mistake for new gear users. Utilizing steroids will all be for nothing should you don’t get your diet and training right25. Again, this extremely depends on your targets and why you’re doing a cycle. Bulking and cutting may have two very different diets and workout methods.
Though some women may expertise fewer virilization effects with Anavar compared to different steroids, individual responses range, and there can nonetheless be significant risks concerned. The follow-up cycle to this commonly begins with a dose of 20 mg as an alternative of 15 mg and is extended as a lot as 8 weeks. Some males opt to take an effective aromatase inhibitor (AI) corresponding to Arimidex alongside testosterone, to lower the probabilities of these dreaded man boobs. However, that, in flip, has its personal side effects – exacerbating your blood strain.
For a start, it has half the androgenic energy of testosterone, so in principle, girls ought to be succesful of run EQ with less risk of virilization. Females can get not solely important positive aspects whereas on EQ, however many will find a important enchancment within the high quality of nails, hair, and pores and skin as nicely. “I thought it was weak until week 12.” – this comment completely summarizes lots of our first-time experiences with EQ. Though I didn’t have to wait so long as 12 weeks to see effects, it makes you surprise if your cycle is doing something for the primary month or two.
HGH users often report complications and other signs much like flu. These are normally very short-term and often subside inside a short while of beginning HGH use. For all its distinctive advantages and the reality that this can be a hormone we naturally produce, HGH certain does come with some vital risk elements when you use it exogenously. Taking too much HGH and taking it for extended intervals can potentially lead to some extreme and scary health points. If PCT is required, a regular Nolvadex 4-week cycle is enough.
Anabolic steroids are artificial copies of the main male sex hormone, testosterone. They are produced to imitate the anabolic (building muscle tissue) and androgenic (developing males and masculinity) action of testosterone. Bodybuilders consume them in an attempt to be stronger, achieve muscle, and be enhanced.
Sometimes, a cycle for testosterone enanthate and Dianabol lasts for 15 weeks. Testosterone is doubtless one of the most commonly used steroids for newbies in their first cycles. This is because testosterone brings huge features, while also steering away from harsher side effects.
You can lower the dosage gradually again down on the end of the cycle to encourage your body to adjust with out the SARMs once the cycle ends. While there are some similarities to steroids in terms of the anabolic properties of SARMs, their androgenic exercise is way weaker. Anabolic steroids bind to many androgen receptors throughout the body. This is how we get such a big discount in androgenic-type side effects while still getting benefits like muscle progress. Every SARM is completely different, however most are designed to bind to skeletal muscle tissue receptors.
This website positively has all of the tidings and facts I needed to this subject and didn’t identify who to ask.
Thanks on putting this up. It’s okay done.
Youthful sexual spontaneity may be replaced by mindful planning with buy viagra connect. Private solutions sent with care to protect your privacy.
buy zithromax 250mg – sumycin 500mg tablet buy metronidazole 200mg generic
svt-stroy.ru – Все о стройке и ремонте. Разбираем подробно – Что делать если гудит кран в нашем строительном блоге. Советы опытных специалистов дизайнеров и инженеров Ремонтируйте свой загородный дом с умом
buy Fildena 100 cheap: fildena.homes – Fildena 100
buy rybelsus 14 mg for sale – rybelsus 14mg usa order cyproheptadine 4mg online cheap
buy cheap domperidone – domperidone 10mg usa how to buy flexeril
inderal us – clopidogrel 75mg without prescription methotrexate 5mg uk
oral zithromax – tinidazole 300mg brand order bystolic 5mg without prescription
https://belviagra.com/# viagra over the counter
order coumadin 5mg generic – coumamide cozaar 25mg us
purchase meloxicam online cheap – https://moboxsin.com/ order mobic 7.5mg generic
order deltasone 10mg generic – aprep lson deltasone cheap
Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.
https://stromectool.com/# ivecop 12
best ed medication – fast ed to take site generic ed pills
amoxil drug – purchase amoxil for sale buy amoxicillin pill